Présentation et manipulation du logiciel IRIS –
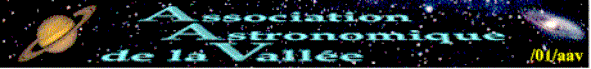
Traitement
des images planétaires
(traitement d’image)

Cette présentation a pour objectif de présenter les
principales fonctions nécessaires à la prise en main du logiciel et au
traitement d’images planétaires. Ce document ne remplace d’aucune manière la
documentation qui est très complète et qui ne se limite pas à ces quelques
fonctions. Je vous invite à la consulter. Il pourra être envisagé de réaliser
un CD avec le site complet pour les personnes intéressées.
Un document complémentaire pourra être fait sur le
traitement des images du ciel profond.
Présentation
1- Prise en main du logiciel
2- Prétraitement des images planétaires
§
Sélection
des images
§
Normalisation
du fond du ciel
§
Alignement
des images
§
Compositage
§
Commande
automatique
3- Traitement des images planétaires
§
Masque
flou
§
Ondelettes
§
Vancittert
4- Exemples de scripts
1- Prise en main du logiciel
La première chose à faire est de configurer le
logiciel en :
1-
indiquant
le répertoire de travail, où seront générés les fichiers temporaires et les
fichiers de travail, ainsi que les images sur lesquelles on veut réaliser des
traitements,
2-
spécifier
le format du type de fichier : FIT

Pour l’ouverture de la console, cliquer sur l’icône
indiquée ci-dessous. La console est la base du logiciel Iris, puisque c’est à
partir de celle-ci que l’ensemble des commandes peuvent être tapées.
Astuces :
§
il
est toujours nécessaire d’avoir le signe >
devant la commande pour que celle-ci soit prise en compte.
§
lorsque
vous ne savez plus quels paramètres sont nécessaires pour une commande, il suffit
de la taper et Iris renvoie la syntaxe.
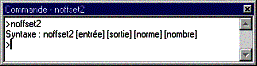 Exemple :
Exemple :
§
En
cochant, la case console multiples,
il est possible d’ouvrir plusieurs consoles.
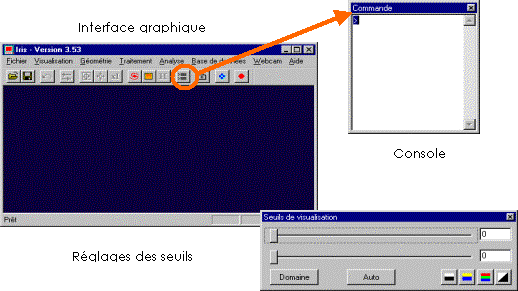
L’ensemble des commandes dans Iris sont données sous
la forme :
>commande [param1] [param2] ...
les valeurs entre crochets sont les paramètres ou
noms d’images à rentrer, mais les crochets ne sont pas nécessaires. Les noms de
commande peuvent être rentrés en minuscule dans la console.
Astuces :
§
Il
est possible de remonter sur des commandes déjà tapées, comme dans un éditeur
de texte avec les flèches, pour modifier un paramètre ou un nom afin d’exécuter
de nouveau la commande sans avoir à tout retaper.
§
Il
est possible de faire du copier coller dans la console. Cela est très pratique
car cela permet de récupérer des trames de scripts déjà réalisés.
2-
Prétraitement des images planétaires
2-1 Ouverture des images
Ouverture des images
§
Ouverture
d’une image seule, au format FIT :
>load
[nom image]
§
Ouverture
d’une image seule ou d’une séquence d’images, au format BMP (le nom de
celle-ci doit être de la forme nom suivi d’un numéro) :
>convertbmp24
[nom image] [rouge] [vert] [bleu] [nb images]
Astuce :
§
Si
les images bmp sont au format : nom0001, nom0002 à nom000n, il est
possible de les remettre sous la seule forme acceptée par Iris pour les
traitements, c’est-à-dire : nom1, nom2, etc., à l’aide de la
commande :
>convert_index [nom entrée]
[nom sortie] [nb images]
Ouverture d’un film de type AVI
Depuis le menu déroulant :
Fichier > Conversion d’Avi...
Il faut alors aller chercher le fichier AVI. Spécifier le type d’images exportées et donner des noms aux différents canaux (R, V et B) et cocher la case « Suppression des redondances », puis faire convertir.
ATTENTION, cela génère de nombreux fichiers et il faut prévoir de l’espace sur le disque sous peine de voir une erreur en cours de conversion !
2-2
Normalisation du fond du ciel
Cette étape permet de ramener le niveau du fond du
ciel à zéro. Cela est nécessaire notamment sur le canal bleu des images webcam
qui est le plus bruité. Cela peut également aidé dans les opérations de
sélection et d’alignement détaillées ci-après.
Les commandes sont les suivantes :
>noffset2
[nom entrée] [nom sortie] 0 [nb images]
la normalisation est faite sur toute l’image
indépendamment de l’info comprise dans l’image.
>noffset3
[nom entrée] [nom sortie] 0 [nb images]
la normalisation est faite sur une zone référence de
l’image (sélectionnée au préalable avec la souris), cela permet de pas altérer
trop la partie utile de l’image (planète par exemple).
Ces commandes sont également accessibles depuis les
menus déroulants par :
Traitement > Normalisation de l’offset d’une
séquence...
2-3 Sélection
des images
Cela se fait par l’intermédiaire des
commandes :
>bestof
[nom entrée] [nb images]
qui sélectionne les meilleures images parmi une
séquence d’images.
Il faut ensuite reclasser et numéroter les images
sélectionnées par la commande :
>select
[nom entrée] [nom sortie]
Astuces :
§
Il
est préférable de faire cette opération sur le canal vert des images webcam,
car c’est le canal le plus contrasté et le moins bruité.
§
Si
votre séquence n’est pas trop bougé, il est possible de faire un rectangle sur
l’image avec la souris pour ne travailler que sur une partie de l’image pour
gagner du temps.
§
Sur
des images contrastées comme celles de la Lune, il est possible d’utiliser la
commande bestof2, plus adaptée à ce type
d’images.
Il existe également une sélection manuelle des
images qui permet de ne choisir que celles qui vous conviennent. L’appréciation
est alors visuelle. Cela est pratique lorsque les images ne sont pas trop
nombreuses, et que le jugement est aisé (cas des images du ciel profond, où il
est possible de juger facilement du filé d’une étoile).
Cette option est accessible depuis les menus
déroulant :
Visualisation > Sélection
d’images...
2-2 Alignement
des images
Images de Jupiter / Mars
Ces planètes sont des « cercles ». Il est
possible d’utiliser une combinaison de commandes permettant d’aligner des
objets étant des cercles de la façon suivante :
Faire un rectangle autour de la planète et centrée
sur celle-ci avec la souris
>circle
[seuil]
Plus la valeur du seuil augmente, plus petit est le
cercle. Le cercle doit être au plus proche du pourtour de la planète.
>cregister
[nom entrée] [nom sortie] [seuil] [nb images]
Le traitement est aussi accessible depuis le menu
déroulant par :
Traitement > Registration des images
planétaires (2)...
Astuces :
§
Cocher
la case Spline. L’avantage de
l’interpolation spline est de moins lisser les images et donc de mieux
conserver les détails. En revanche le temps de calcul est plus long.
§
Depuis
la console, il faut faire au préalable la commande : >setspline 1
Tout type d’images (Lune, Saturne, Soleil, etc.)
L’alignement se fait par intercorrelation entre les
images, d’où une précision d’alignement accrue au prix d’un temps de calcul plus
long par rapport à la méthode précédente.
La commande est :
>pregister
[nom entrée] [nom sortie*] [taille en pixels**] [nb images]
* le nom de sortie génère des fichiers temporaires
qui pourront être écrasés à l’étape suivante.
** la taille en pixels correspond à la taille
utilisée pour réaliser l’intercorrelation, celle-ci doit être un multiple de 2
(128, 256, 512), à savoir que plus cette taille est élevée, plus long sera le
calcul. Cela dépend beaucoup des images à aligner.
Cette commande a permit de générer un fichier contenant les décalages entre les différentes images. Il faut maintenant effectuer la translation des différentes images, sur les trois canaux, à l’aide de la commande :
>file_trans
[nom entrée] [nom sortie] [nb images]
Astuce :
§
Afin
de réduire les temps de traitement, les opérations pregister et file_trans
peuvent être réalisées que sur les premières images, si la sélection a été
réalisée au préalable.
Le traitement est aussi accessible depuis le menu
déroulant par :
Traitement > Registration des images
planétaires (1)...
2-3
Compositage
L’objectif du compositage est d’augmenter le rapport
signal sur bruit. Ce rapport est multiplié par la racine carrée du nombre
d’images additionnées. S/N sera donc multiplié par 2 pour 4 images additionnées
par exemple.
Plusieurs commandes permettent de compositer les
images dans Iris.
La plus simple, pour le traitement des images
planétaires, est la suivante :
>add2
[nom image] [nb images]
Cela fait une addition des images, il est alors
nécessaire d’ajuster les seuils dans la fenêtre réglages des seuils.
Si le nombre d’images à additionner est supérieur à
128 (32767/255) alors il y aura une saturation de l’image. Pour palier à cela,
il existe la commande :
>add_norm
[nom image] [nb images]
Cette commande multiplie les images par un
coefficient pour ne pas dépasser le seuil max de 32767.
Astuce :
§
Il
existe une autre commande intéressante qui permet d’additionner les images par paquet.
Cela est pratique pour voir par exemple le résultat de l’addition des 50
premières images d’un film, des 50 suivantes etc. Ensuite il est toujours
possible de re-additionner toutes ces images. La commande est :
>copyadd [nom
entrée] [nom sortie] [nb images par paquet] [nb total images]
Il ne faut surtout pas oublier d’enregistrer le résultat du compositage de chaque canaux (RVB), au format FIT, avec la commande :
>save
[nom image]
2-4
Combinaison des plans couleurs : trichromie
Tout le travail effectué jusqu’à présent a été fait
sur des images FIT noires et blanc. Il est maintenant possible de reconstituer
l’image couleur compositée pour la sauvegarder sous un format type Bmp.
Cette opération est réalisable depuis le menu
déroulant :
Visualisation > Trichromie...
Ou par la commande :
>trichro
[nom image rouge] [nom image verte] [nom image bleu]
La balance des couleurs peut être ajustée depuis le
menu déroulant :
Visualisation > Balance des
blancs...
Pour sauvegarder l’image, il faut ensuite
faire :
>savebmp
[nom image]
Astuce :
§
Pour
donner une nouvelle vision à vos images, il est possible d’utiliser la
technique de reconstitution des couleurs dite LRGB. Le L correspond à une
couche luminance. En CCD classique, cette couche luminance correspond à la
prise d’image sans filtre coloré et c’est la couche la plus détaillée. C’est
sur celle-ci que les traitements sont normalement réalisés.
§
Avec
les webcams, il est possible d’utiliser la couche verte ou rouge comme une
pseudo couche luminance. Réaliser vos traitements sur l’une de ces couches et
sauver la. Dans le menu Trichromie... cocher
ensuite la case luminance et entrer le nom de votre image. Ajuster le curseur
sur la droite. Vous donnerez une nouvelle vie à vos images !
2-5 Commande
automatique (extrait
de la doc Iris)
La syntaxe est :
>compute_trichro1
[maître] [r] [v] [b] [taille] [nb images sélectionnées] [nb total images]
§
[maître]
est le nom générique d'une séquence d'image à partir de laquelle IRIS va faire
le tri des meilleures images et calculer les paramètres de registration pour
les 3 plans couleurs. La séquence d'images maître doit contenir si possible des
images bien posées, peut bruitées et détaillées. Généralement, dans le cas de
l'usage d'une caméra du type Webcam, on choisira ici les images correspondant
au plan de couleur verte.
§
[r],
[g], [b] sont les noms génériques des images issues des plans couleurs rouge,
vert et bleu respectivement.
§
[taille]
est la taille de la zone de calcul pour la registration (choisir parmi les
valeurs 128, 256, 512 par exemple).
§
[nb
images sélectionnées] est le nombre d'images additionnées lors du compositage
final. C'est un nombre égal ou inférieur au nombre d'image total à traiter et
dont la valeur est dépendante du degré de turbulence.
§
[nb
total images] est le nombre total d'images à traiter.
Cette commande réalise le traitement automatique
d'images trichromes des planètes. Elle enchaîne les commandes bestof, select, pregister et add_norm,
ceci pour les 3 plans couleurs. A la fin du traitement l’image trichrome
apparaît à l'écran (vous pouvez alors la sauvegarder sur le disque avec la
commande savebmp ou ajuster son équilibre
chromatique avec la commande Balance des blancs...
du menu Visualisation par exemple).
compute_trichro1 produit aussi
automatiquement les 3 images @r, @g, @b (sans indices) qui représentent
l'addition des n meilleures images pour les 3 plan couleurs, le paramètres n
étant fourni par l'opérateur.
Il y a une autre commande, utilisant la commande cregister pour l’alignement, pour les planètes
présentant un contour circulaire. La syntaxe est :
>compute_trichro2
[maître] [r] [v] [b] [seuil] [nb images sélectionnées] [nb total images]
le seuil correspond à la valeur rentrée dans un
commande de type circle.
2-6 Ajustement
des couleurs
Il existe une fonction dans Iris, qui permet
d’ajuster les couleurs des trois plans couleur en se référant à un plan de
référence. Un facteur multiplicatif est alors appliqué eu deux autres plans.
Cette opération est à réaliser après compositage.
La commande est la suivante :
>scalecolor
[entrée] [sortie] [index de référence] [nombre]
l’index de référence est le numéro du plan de
référence pour connaître le facteur à appliquer.
Ex : si les plans couleurs RVB s’appellent
respectivement image1, image2 et image3 et que l’on souhaite ajuster les plans
par rapport au plan vert, cela donne :
>scalecolor image jupiter 2 3
Cette fonction est à essayer, les résultats sont parfois à réajuster encore avec la balance des blancs, suivant les paramètres de vue initiaux.
3- Traitement des images
A ce stade, il ne reste plus qu’à traiter les
images. Il existe plusieurs algorithmes de traitement, accessibles pour la
plupart depuis le menu déroulant : Traitement.
(Les commandes sont indiquées pour information).
La règle générale pour le traitement, c’est de faire
des essais. Il n’existe pas de règle ! ! De plus tout dépend de ce
que l’on cherche (détails, esthétisme, etc.).
3-1 Masque
flou (Traitement > Masque flou...)
Ce traitement est l’un des plus connu. Il permet de
renforcer les détails de basse fréquence.
>unsharp
[sigma] [coef] [flag*]
* flag=0 pour le stellaire , flag=1 pour le
planétaire
Le masque flou peut être réalisé sur une séquence
d’images : Traitement > Masque flou d’une
séquence... ou
>unsharp2
[sigma] [coef] [flag*]
Astuce :
§
Le
traitement par masque flou d’une séquence peut être avantageusement utilisé
avant une étape de sélection d’images pour renforcer le contraste de chacune.
Il faut néanmoins faire attention à ne pas trop faire ressortir le bruit.
§
Il
est également possible de compositer des images ayant subies au préalable un
masque flou.
3-2 Vancittert
Ce traitement itératif est assez efficace pour faire
ressortir les détails sur les surfaces planétaires.
>vancittert
[fwhm] [nb itération]
le coefficient fwhm correspond à la largeur à mi-hauteur de la distribution de lumière d’une étoile. Concrètement, plus cette valeur est petite, plus les détails fins seront mis en valeur. Il faut faire des essais pour se rendre compte sur chaque image. Commencer avec une valeur de 7, par exemple, pour C8, avec 4 ou 5 itérations.
3-3 Ondelettes (Traitement > Ondelettes...)
Ce traitement décompose l’image avec des plans de niveau de détails différents. Les plans intéressant sont les plans 2 et 3.
>wavelet [nom 1] [nom 2] [nb plans]
exemple :
>wavelet x y 6 /*traitement par Ondelettes
>load x1 /*chargement de l’image x1
>add y3 /*addition des détails contenus dans le plan 3
>add y3 /*répétition de l’opération pour renforcer ces détails
>add y2 /*addition des détails contenus dans le plan 2
> add y2 /*répétition de l’opération pour renforcer ces détails
etc.
Astuce :
§ Il est possible de combiner plusieurs de ces traitements, mais là c’est à vous de jouer et d’expérimenter ! !
4- exemple de scripts
Conversion d’un film avi, de 100 images, en trois plans r v et b. (à faire depuis le menu déroulant Fichier > Conversion d’Avi...). Exemple d’un compositage de 50 images.
|
Exemple de script |
Exemple de script « automatisé » |
|
>load
r1 >noffset3
r @r 0 100 >noffset3
v @v 0 100 >noffset3
b @b 0 100 >bestof
@r 100 >select
@r r >select
@v v >select
@b b >load
r1 >pregister
r @r 256 100 >file_trans r @r 100 >file_trans
v @v 100 >file_trans
b @b 100 >add2
@r 50 >save
rouge >add2
@v 50 >save
vert >add2
@b 50 >save bleu >trichro rouge vert bleu >savebmp jupiter >load rouge >vancittert 7 4 >save lum Faire un essai de trichromie avec comme couche luminance, l’image lum. |
>load
r1 >compute_trichro1
v r v b 50 100 >savebmp
jupiter >load
@r >unsharp 1.5 2 1 >save lum Faire un essai de trichromie avec comme couche luminance, l’image lum. La normalisation du fond du ciel n’a pas été faite ici. |
Nota :
Tout ceci est un exemple, mais il peut vous servir de base pour commencer. Il suffit de faire un copier / coller du script dans la console et de faire les commandes les unes après les autres.